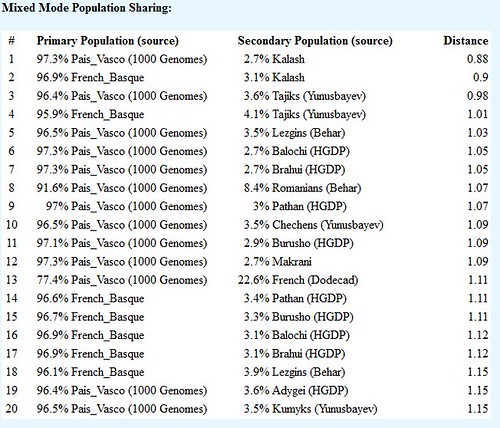Je me propose d'analyser très brièvement les résultats électoraux du 1er tour des élections présidentielles dans le Sud-Ouest de la France qui me semblent mettre en avant deux faits peu étudiés :
- Consolidation du vote frontiste dans la vallée de la Garonne depuis l'estuaire de la Gironde jusqu'en amont de Toulouse et émergence de nouveaux foyers de vote extrême.
- Consolidation de la dichotomie entre campagnes rurbanisées et centre-villes bobos, ce phénomène n'étant pas sans relation avec le précédent.
I - Une carte politique inchangée en apparence
Il faut dire que de prime abord, les résultats du 1er tour ne semblent pas faire émerger de nouvelles tendances : le Sud-Ouest de la France (je m'intéresse essentiellement aux régions administratives iniques dites Aquitaine et Midi-Pyrénées) reste une région de centre-gauche, conformément à son histoire politique radical-socialiste. A ce titre, le vote Hollande a eu les faveurs d'une majorité de l'électorat.
D'autres grandes tendances persistent : le Pays Basque intérieur (Soule exceptée) reste marqué par le vote à droite anciennement RPR, le vote "Inchauspé" j'ai envie de dire. Tout comme d'ailleurs l'Aveyron même si au fil des années on constate un basculement vers la gauche (pour un phénomène similaire, cf le vote breton sur 30 ans). Les Landes restent une terre de gauche, tout comme le Sud-Gironde voire le Tarn. Mais en somme, ces phénomènes ne sont pas intéressants, c'est le temps long d'une génération politique, les nouveautés à ce titre sont bien plus intéressantes car elles permettent d'induire ce qu'il en sera dans 20-30 ans.
II - Les nouvelles tendances qui dessinent l'avenir
1. Le vote abertzale au Pays Basque
Parmi ces nouvelles tendances, l'une qui retient mon attention, c'est l'importance toute relative et conjuguée du vote Poutou-Joly (jusqu'à 15%) dans le Pays Basque intérieur. Très clairement, se dessine là l'émergence d'un vote abertzale qui parvient, autant que je sache, à convertir parmi la jeunesse paysanne de Basse-Navarre et du Labourd intérieur, l'ancien vote conservateur traditionnel ex-RPR en vote alter, avec ce paradoxe de l'Histoire que ce nouveau vote est tout aussi patriote que l'ancien, je veux dire par là qu'il n'est qu'une adaptation à la nouvelle donne historique, contre un certain changement, contre une normalisation sur un modèle français (cf les luttes sur la chambre d'agriculture par exemple). De la même manière qu'au Pays Basque espagnol, le carlisme a donné le vote Amaiur d'aujourd'hui.
En tout état de cause, la constitution d'une conscience politique basque se renforce, Soule exceptée, le gouffre avec le Béarn n'a jamais été aussi grand, ce qui pose véritablement la question du dialogue politique à l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques à l'avenir. Il ne faut évidemment pas prendre en compte les résultats de la côte, c'est une colonie de retraités franciliens.
2. Le vote frontiste dans la vallée de la Garonne
L'autre phénomène intéressant, c'est bien évidemment le vote frontiste, et sa dynamique propre dans le Sud-Ouest. J'identifie désormais une "vallée" frontiste, celle de la Garonne (en rouge).
Je me propose de faire une brève analyse de l'embouchure aux environs de Toulouse :
- En Médoc, le vote FN est très clairement la rencontre de votes qui auparavant trouvaient leur satisfaction dans d'autres candidats : le vote chasseur (ex-Nihous) et le vote viticole (ex-RPR). Les mêmes causes expliquant les mêmes conséquences, il doit être possible d'induire des raisonnements similaires pour la rive charentaise de l'estuaire ("Cognac"), le Nord-Gironde et l'Entre-Deux-Mers.
- Il faut noter que les Graves et les environs de Langon restent néanmoins fidèles au vote de gauche. La donne change dès que l'on entre en Réolais qui annonce le vote lot-et-garonnais des villes de la plaine (Marmande, Tonneins, ...). A mon sens, l'analyse est relativement claire : il s'agit d'un vote de rejet des populations immigrées en nombre important dans ces villes. Ce vote est porté par les descendants à la 3ème génération des immigrés italiens, en nombre dans cette vallée maraichère, venus "coloniser" cette terre après les massacres de 14-18, sur impulsion de la IIIème République. Il faut y ajouter l'adstrat du vote pied-noir, notamment vers Montauban. Au fond, on a là un vote assez similaire à ce qui se passe en Provence.
La nouveauté de ce vote frontiste, c'est qu'il s'étend désormais aux communes rurales aux alentours. Là aussi, il rallie le vote chasseur. Mais à mon avis, son apport le plus important provient du vote rurbain, celui des classes moyennes "blanches" déclassées qui font construire à la campagne pour pas cher leur petit pavillon dégueulasse. J'y reviendrai, je pense que c'est la constituante principale du vote FN en Toulousain.
- Toulouse est clairement perdue pour la droite et sans-doute à long terme. Les raisons sont simples, c'est la conjonction du vote banlieusard et du vote bobo du centre-ville, les classes plus huppées traditionnellement à droite ayant migré en périphérie, tandis que les classes ouvrières et moyennes "blanches", qui ont opéré un transfert du PCF/PS vers le FN, ont également été exfiltrées des villes pour des raisons foncières, se retrouvant à la campagne, condamnées à des vies de "commuteurs".
C'est donc là à mon sens les raisons du vote FN dans les vallées de la Lèze, de l'Arize, et plus généralement en Murétain et Volvestre, bref en amont de Toulouse, dans ce qui est le paradis pavillonnaire rurbain. L'exil des classes moyennes des villes a pour conséquence la consolidation d'un vote de rejet des élites traditionnelles. C'est le monde des petits entrepreneurs, des salariés déclassés qui passent leur budget en essence, des lotissements uniformes. De manière tout à fait consciente, la classe politique n'entend plus parler à cet électorat, du moins n'entendait plus le faire. Il faut dire que d'une certaine manière, toute la France institutionnelle - notamment la décentralisation mal ficelée à la française qui emporte la concurrence des communes de périphérie pour attirer les nouveaux-venus, au lieu de les concentrer en ville - est organisée de façon à favoriser ce clivage entre ville et campagne rurbaine, forcées de cohabiter dans la référence métropolitaine, mais qui développent des sociologies irrémédiablement distinctes.
Pour caricaturer les choses, disons que la France contemporaine, ce sont des métropoles constituées comme suit :
- un centre-ville où s'épanouit une population bobo déconnectée des enjeux réels, bénéficiant des savoirs et de la mondialisation, en communication avec le monde via un réseau de transport efficient (TGV, avion,, ...). Ces populations votent centre-gauche, écolo, centriste. Et Mélenchon parfois pour s'encanailler. Elles constituent le background culturel de l'élite française.
- des "Bantustans" en périphérie proche où se développe une culture parallèle dite "de banlieue" (en fait, une culture mondialisée de ghetto, rendue possible par la mondialisation médiatique, la même depuis les faubourgs pakistanais de Londres jusqu'au Bronx) culture sur laquelle un service public de l'éducation déficient n'a plus prise. Ces populations votent "communautaire", en l'espèce PS, dans la mesure où les élites socialistes y ont généralement constitué leur clientèle électorale, parfois de façon très consciente (cf Terranova).
- des villes "blanches" en périphérie lointaine, peuplées des anciennes classes laborieuses des villes, tout du moins de leurs descendants, vivant dans le rêve d'une France de propriétaires, de la tondeuse le samedi, de la piscine l'été. Ces populations ont voté Sarkozy en 2007, Le Pen en 2012.
Si l'on devait appliquer à Toulouse, ce modèle, on a bien un centre-ville bobo (Carmes, ...), des Bantustans (Le Mirail, ...) et la périphérie lointaine "blanche" (la vallée de la Garonne en amont, jusque très loin en Comminges).
Je pense que ce phénomène d'éclatement géographique a pour conséquence que pour la première fois depuis longtemps, la sociologie politique d'une région donnée colle avec sa situation géographique. Cette analyse demanderait confirmation dans d'autres métropoles. Mais aussi dans des villes petites ou moyennes : une ville comme Tonneins semble répondre à ce schéma (centre-ville encore relativement à gauche, communes rurbaines voisines comme Fauillet ou Varès pour le FN).
En tout état de cause, ce phénomène de la rurbanisation - renforcé par l'héliotropisme - expliquera dans les années à venir la montée en puissance du FN dans le Sud-Ouest de la France, à l'image de ce qui s'est passé en Provence. On constate ainsi déjà par exemple dans la Haute-Lande des foyers de pénétration très surprenants, mais qui sont bien en phase avec ce que l'on sait du boom démographique (lire : populations franciliennes fuyant la banlieue) dans cette partie du département, non loin de la côte.
Quant à la leçon politique à tirer de tout cela, l'analyse froide des données ne suffisant pas à mon sens, elle est double :
- c'est l'échec de décennies de politiques françaises, notamment en matière d'aménagement du territoire, de politique industrielle et de décentralisation. Il faut à tout prix mettre fin à l'étalement urbain (qui de toute façon n'est pas viable, ni écologiquement, ni socialement), se doter du cadre juridique nous permettant de maintenir in situ une industrie (pourquoi pas sous la forme de coopératives ?) et revenir sur la décentralisation de 1982 qui n'a pas donné aux bons échelons les bonnes compétences (la commune ne doit plus disposer de la compétence urbanistique).
- toute personne désireuse de se lancer dans la vie publique, de gauche comme de droite, devra tenir compte de ces données nouvelles, devra chercher à parler à l'électorat FN, ne pas l'ostraciser donc, bien au contraire, car c'est lui qui dans les années à venir déterminera les politiques à suivre ...
- Consolidation du vote frontiste dans la vallée de la Garonne depuis l'estuaire de la Gironde jusqu'en amont de Toulouse et émergence de nouveaux foyers de vote extrême.
- Consolidation de la dichotomie entre campagnes rurbanisées et centre-villes bobos, ce phénomène n'étant pas sans relation avec le précédent.
I - Une carte politique inchangée en apparence
Il faut dire que de prime abord, les résultats du 1er tour ne semblent pas faire émerger de nouvelles tendances : le Sud-Ouest de la France (je m'intéresse essentiellement aux régions administratives iniques dites Aquitaine et Midi-Pyrénées) reste une région de centre-gauche, conformément à son histoire politique radical-socialiste. A ce titre, le vote Hollande a eu les faveurs d'une majorité de l'électorat.
D'autres grandes tendances persistent : le Pays Basque intérieur (Soule exceptée) reste marqué par le vote à droite anciennement RPR, le vote "Inchauspé" j'ai envie de dire. Tout comme d'ailleurs l'Aveyron même si au fil des années on constate un basculement vers la gauche (pour un phénomène similaire, cf le vote breton sur 30 ans). Les Landes restent une terre de gauche, tout comme le Sud-Gironde voire le Tarn. Mais en somme, ces phénomènes ne sont pas intéressants, c'est le temps long d'une génération politique, les nouveautés à ce titre sont bien plus intéressantes car elles permettent d'induire ce qu'il en sera dans 20-30 ans.
II - Les nouvelles tendances qui dessinent l'avenir
1. Le vote abertzale au Pays Basque
Parmi ces nouvelles tendances, l'une qui retient mon attention, c'est l'importance toute relative et conjuguée du vote Poutou-Joly (jusqu'à 15%) dans le Pays Basque intérieur. Très clairement, se dessine là l'émergence d'un vote abertzale qui parvient, autant que je sache, à convertir parmi la jeunesse paysanne de Basse-Navarre et du Labourd intérieur, l'ancien vote conservateur traditionnel ex-RPR en vote alter, avec ce paradoxe de l'Histoire que ce nouveau vote est tout aussi patriote que l'ancien, je veux dire par là qu'il n'est qu'une adaptation à la nouvelle donne historique, contre un certain changement, contre une normalisation sur un modèle français (cf les luttes sur la chambre d'agriculture par exemple). De la même manière qu'au Pays Basque espagnol, le carlisme a donné le vote Amaiur d'aujourd'hui.
En tout état de cause, la constitution d'une conscience politique basque se renforce, Soule exceptée, le gouffre avec le Béarn n'a jamais été aussi grand, ce qui pose véritablement la question du dialogue politique à l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques à l'avenir. Il ne faut évidemment pas prendre en compte les résultats de la côte, c'est une colonie de retraités franciliens.
2. Le vote frontiste dans la vallée de la Garonne
L'autre phénomène intéressant, c'est bien évidemment le vote frontiste, et sa dynamique propre dans le Sud-Ouest. J'identifie désormais une "vallée" frontiste, celle de la Garonne (en rouge).
Je me propose de faire une brève analyse de l'embouchure aux environs de Toulouse :
- En Médoc, le vote FN est très clairement la rencontre de votes qui auparavant trouvaient leur satisfaction dans d'autres candidats : le vote chasseur (ex-Nihous) et le vote viticole (ex-RPR). Les mêmes causes expliquant les mêmes conséquences, il doit être possible d'induire des raisonnements similaires pour la rive charentaise de l'estuaire ("Cognac"), le Nord-Gironde et l'Entre-Deux-Mers.
- Il faut noter que les Graves et les environs de Langon restent néanmoins fidèles au vote de gauche. La donne change dès que l'on entre en Réolais qui annonce le vote lot-et-garonnais des villes de la plaine (Marmande, Tonneins, ...). A mon sens, l'analyse est relativement claire : il s'agit d'un vote de rejet des populations immigrées en nombre important dans ces villes. Ce vote est porté par les descendants à la 3ème génération des immigrés italiens, en nombre dans cette vallée maraichère, venus "coloniser" cette terre après les massacres de 14-18, sur impulsion de la IIIème République. Il faut y ajouter l'adstrat du vote pied-noir, notamment vers Montauban. Au fond, on a là un vote assez similaire à ce qui se passe en Provence.
La nouveauté de ce vote frontiste, c'est qu'il s'étend désormais aux communes rurales aux alentours. Là aussi, il rallie le vote chasseur. Mais à mon avis, son apport le plus important provient du vote rurbain, celui des classes moyennes "blanches" déclassées qui font construire à la campagne pour pas cher leur petit pavillon dégueulasse. J'y reviendrai, je pense que c'est la constituante principale du vote FN en Toulousain.
- Toulouse est clairement perdue pour la droite et sans-doute à long terme. Les raisons sont simples, c'est la conjonction du vote banlieusard et du vote bobo du centre-ville, les classes plus huppées traditionnellement à droite ayant migré en périphérie, tandis que les classes ouvrières et moyennes "blanches", qui ont opéré un transfert du PCF/PS vers le FN, ont également été exfiltrées des villes pour des raisons foncières, se retrouvant à la campagne, condamnées à des vies de "commuteurs".
C'est donc là à mon sens les raisons du vote FN dans les vallées de la Lèze, de l'Arize, et plus généralement en Murétain et Volvestre, bref en amont de Toulouse, dans ce qui est le paradis pavillonnaire rurbain. L'exil des classes moyennes des villes a pour conséquence la consolidation d'un vote de rejet des élites traditionnelles. C'est le monde des petits entrepreneurs, des salariés déclassés qui passent leur budget en essence, des lotissements uniformes. De manière tout à fait consciente, la classe politique n'entend plus parler à cet électorat, du moins n'entendait plus le faire. Il faut dire que d'une certaine manière, toute la France institutionnelle - notamment la décentralisation mal ficelée à la française qui emporte la concurrence des communes de périphérie pour attirer les nouveaux-venus, au lieu de les concentrer en ville - est organisée de façon à favoriser ce clivage entre ville et campagne rurbaine, forcées de cohabiter dans la référence métropolitaine, mais qui développent des sociologies irrémédiablement distinctes.
Pour caricaturer les choses, disons que la France contemporaine, ce sont des métropoles constituées comme suit :
- un centre-ville où s'épanouit une population bobo déconnectée des enjeux réels, bénéficiant des savoirs et de la mondialisation, en communication avec le monde via un réseau de transport efficient (TGV, avion,, ...). Ces populations votent centre-gauche, écolo, centriste. Et Mélenchon parfois pour s'encanailler. Elles constituent le background culturel de l'élite française.
- des "Bantustans" en périphérie proche où se développe une culture parallèle dite "de banlieue" (en fait, une culture mondialisée de ghetto, rendue possible par la mondialisation médiatique, la même depuis les faubourgs pakistanais de Londres jusqu'au Bronx) culture sur laquelle un service public de l'éducation déficient n'a plus prise. Ces populations votent "communautaire", en l'espèce PS, dans la mesure où les élites socialistes y ont généralement constitué leur clientèle électorale, parfois de façon très consciente (cf Terranova).
- des villes "blanches" en périphérie lointaine, peuplées des anciennes classes laborieuses des villes, tout du moins de leurs descendants, vivant dans le rêve d'une France de propriétaires, de la tondeuse le samedi, de la piscine l'été. Ces populations ont voté Sarkozy en 2007, Le Pen en 2012.
Si l'on devait appliquer à Toulouse, ce modèle, on a bien un centre-ville bobo (Carmes, ...), des Bantustans (Le Mirail, ...) et la périphérie lointaine "blanche" (la vallée de la Garonne en amont, jusque très loin en Comminges).
Je pense que ce phénomène d'éclatement géographique a pour conséquence que pour la première fois depuis longtemps, la sociologie politique d'une région donnée colle avec sa situation géographique. Cette analyse demanderait confirmation dans d'autres métropoles. Mais aussi dans des villes petites ou moyennes : une ville comme Tonneins semble répondre à ce schéma (centre-ville encore relativement à gauche, communes rurbaines voisines comme Fauillet ou Varès pour le FN).
En tout état de cause, ce phénomène de la rurbanisation - renforcé par l'héliotropisme - expliquera dans les années à venir la montée en puissance du FN dans le Sud-Ouest de la France, à l'image de ce qui s'est passé en Provence. On constate ainsi déjà par exemple dans la Haute-Lande des foyers de pénétration très surprenants, mais qui sont bien en phase avec ce que l'on sait du boom démographique (lire : populations franciliennes fuyant la banlieue) dans cette partie du département, non loin de la côte.
Quant à la leçon politique à tirer de tout cela, l'analyse froide des données ne suffisant pas à mon sens, elle est double :
- c'est l'échec de décennies de politiques françaises, notamment en matière d'aménagement du territoire, de politique industrielle et de décentralisation. Il faut à tout prix mettre fin à l'étalement urbain (qui de toute façon n'est pas viable, ni écologiquement, ni socialement), se doter du cadre juridique nous permettant de maintenir in situ une industrie (pourquoi pas sous la forme de coopératives ?) et revenir sur la décentralisation de 1982 qui n'a pas donné aux bons échelons les bonnes compétences (la commune ne doit plus disposer de la compétence urbanistique).
- toute personne désireuse de se lancer dans la vie publique, de gauche comme de droite, devra tenir compte de ces données nouvelles, devra chercher à parler à l'électorat FN, ne pas l'ostraciser donc, bien au contraire, car c'est lui qui dans les années à venir déterminera les politiques à suivre ...